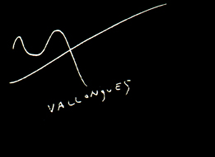(Page en cours de construction)
Petites scènes de la vie d'un peintre est un ouvrage écrit par Catherine Van Rogger, après la mort de Van Rogger, où elle relate l'existence de l'artiste, "faite de détermination et de lucidité".
Ces petites scènes de la vie d'un peintre du XXe siècle n'ont pas l'ambition de rendre ce qu' a été véritablement la vie vécue par cet artiste, "la plainte du fou que le temps recouvre".
Elles ne sont que des pierres déposées dans la conscience du témoin par une vie consacrée à la création.
Rien n'est donc imaginaire, en aucune façon.
Les paroles sont des faits, les noms sont des faits, les faits sont des faits(note de l'éditeur)
Extraits
1952, Paris
Le peintre loue une chambre chez Germaine Tillon, près du bois de Vincennes. Il y a invité la jeune fille. Ils bavardent. Tout à coup, il lui dit:
"Mon père est juif.
- Ah....
- Cela ne te gêne pas?
- Pas du tout."
Il poursuit:
"Mais, moi, je ne suis pas juif. Je suis une mutation. Dés mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que je ne leur appartenais pas. J'ai toujours appartenu à la Poésie et rien qu'à elle.
A sept ans, je savais déjà que je serais peintre. J'étais de plus en plus étranger, et dés que je l'ai pu, à dix huit ans, je suis parti vivre ma vraie vie: le travail de la terre, la communion avec le monde et l'anti-profit. J'ai changé de nom. C'était d'abord un pseudonyme, mais maintenant c'est mon vrai, mon unique nom.
Je suis resté sept ans au Brésil pour ça.
J'allais chaque jour à l'ambassade de Belgique pour réclamer ce changement.
Je ne voulais pas rentrer en Europe sans l'avoir officiellement acquis et sans avoir définitivement perdu l'autre. J'ai quitté le Brésil le jour même où j'ai obtenu ce changement par arrêté royal.
Je me suis construit tout seul. Je suis ma propre race et mes propres ancêtres."
***
1954, le Midi de la France
Le peintre est allé peindre dans la vallée. Il rentre très excité.
"J'ai eu une révélation en peignant! Le monde existe en dehors de nous! C'est cela que je veux peindre:
le paysage tel qu'il est en lui-même, en dehors des saisons, en dehors du jour et de la nuit, en dehors de la lumière changeante des heures. Non pas tel que je le perçois mais tel qu'il est. Tel qu'il est quand personne ne le regarde. Dans sa réalité propre. C'est ça la peinture!"
***
1956, Vallongues
Le peintre a demandé à Madame Simon, une jeune femme qui les avait hébergés quelques temps, si elle voulait bien poser pour un portrait.
Après plusieurs séances de pose, Madame Simon part pour ne plus revenir.
"Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, dit le peintre. Cela ne m'est jamais arrivé.
Lorsque je lui ai montré le tableau, elle m'a gifflé et m'a dit que je lui avais tout pris.
Je vais le continuer sans elle et en faire un chef d'oeuvre."
***
1957, Paris
L'acteur Georges Wilson rencontré l'été précédent chez Guérin, chaleureux, amical - "si vous venez à Paris, passez me voir..."- est debout dans le local.
Il habite le même immeuble, au deuxième étage.
Le peintre avait sonné à sa porte mais n'avait pas été reçu.
"Ecoute, comprends, je n'ai pas une minute à te consacrer. Tiens, en ce moment, pendant que je te parle, je perds de l'argent: plus de vingt personnes m'attendent."
Le peintre, humilié, proteste, suggère, accuse. A la fin, il se tourne vers sa femme,
"Et toi, tu ne dis rien! Qu'en pense-tu?
- Je pense que Georges Wilson est un excellent comédien, il nous l'a prouvé cet été.
- Vous êtes dure, dit l'acteur", et on ne le revit plus.
***
1957, Paris
La femme du peintre retourne à Paris en juin pour faire revenir les toiles.
Dans une galerie rue La Boétie, un sculpteur, ami du peintre, expose.
Elle lui explique : il faut libérer le local ; elle est venue chercher les tableaux. Personne ne les a vus. L’échec est total.
« Il faut porter les toiles aux galeries, dit le sculpteur. A Paris, les marchands ne se déplacent pas.
- Comment faire ? En métro ?
- Prenez un taxi.
- Impossible. Je ne peux pas payer. Tant de travail, cinq ans de luttes et d’efforts, et des tableaux que personne ne veut voir…Il faut pourtant que j’y arrive, il le faut… »
Elle est au bord des larmes. Une vieille dame, vêtue de noir et très distinguée est assise à l’écart.
« Je mettrai ma voiture et mon chauffeur à votre disposition demain toute la journée. Il passera vous prendre à 10 heures, dit-elle.»
La femme du peintre ne trouve pas les mots. Comment remercier pour un miracle ?
Le lendemain, elle les fait toutes, rive droite, rive gauche : galerie de France, Carré, Maeght, Kahnweiler, Jeanne Bucher, galerie Pierre, galerie Rosenberg, et bien d’autres encore.
Bientôt le chauffeur ne prend même pas la peine de couper le contact. Cela va de plus en plus vite.
« Nous n’avons pas le temps de regarder des toiles, remportez tout ça. »
« Nous n’avons que faire de peinture. »
« C’est inutile, nous avons tous nos poulains. »
A la galerie Claude Bernard, on ne lui laisse même pas le temps de sortir les toiles de la voiture.
« Nous ne voulons pas voir. N’insistez pas. Notre écurie est complète. »
Paris est devenu un immense champ de course.
***
1957, Vallongues
Après l’échec de sa réinsertion dans la vie artistique, le peintre comprend, dans une vision fugitive et prémonitoire, que les dés sont jetés : il sait que jamais il ne sera plus admis à Paris.
Son œuvre devra se faire seule sur une trajectoire qui l’éloignera chaque jour davantage du milieu artistique contemporain.
Il lui faut une stratégie et une discipline de fer pour survivre et continuer à créer.
Sa femme décide que son domaine à elle sera la nourriture de la famille.
Lui, il sera responsable de tout ce qui concerne la peinture.
Elle se met en quête de leçons particulières.
Pendant dix ans, elle en donne une ou deux par jour, de quoi acheter le repas du soir et du lendemain midi.
Elle n’a jamais d’argent, mais un petit panier à provisions qu’elle rapporte chaque soir sur sa bicyclette.
On lui donne des vêtements.
Les enfants ne sont jamais malades.
D’un commun accord, ils ne parlent jamais d’argent : on ne parle pas de ce qui n’existe pas.
Il lui arrive simplement d’avoir oublié le journal, les cigarettes, le beurre…
On lui demandera, bien plus tard, de quoi ils vivaient. Elle répondra : « De miracles. »